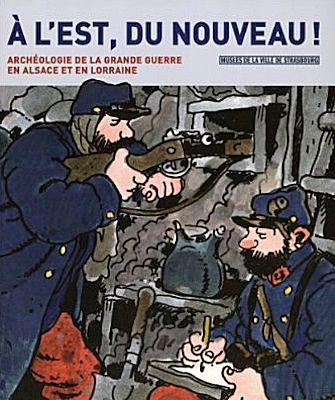WINTZENHEIM 14-18
A l'Est, du nouveau !
Archéologie de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine
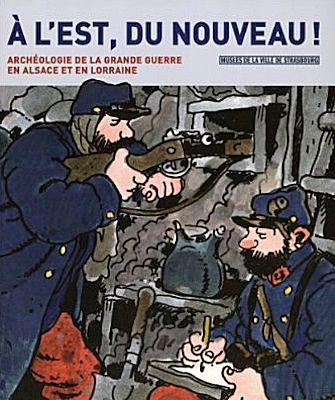 |
La situation géographique de l'Alsace et de la Lorraine, zone-frontière, confère à ces deux régions une place
particulière pour la commémoration du premier conflit mondial. Provinces rattachées depuis 1871 au
Reichsland Elsass-Lothringen
sous administration allemande, avant leur retour à la France en 1918, l'Alsace et la Moselle ont constitué l'un des enjeux du
conflit. Ces territoires présentent ainsi une relation directe avec cette période tragique de l'histoire et la mémoire des
combats reste un élément fort de l'identité régionale.
L'archéologie des conflits contemporains, et tout spécialement du premier conflit mondial, est une branche très novatrice de la
recherche, qui a ouvert récemment de nombreuses perspectives pour les études historiques et qui renouvelle la compréhension
de la vie quotidienne des combattants sur les lignes de front. Des résultats importants ont été obtenus en Alsace et en
Lorraine au cours de la dernière décennie, en particulier à l'occasion d'opérations d'archéologie préventive menées sur des
positions militaires. Le présent ouvrage en dresse un premier bilan et aborde également de nombreuses problématiques
historiques et archéologiques à travers une démarche largement pluridisciplinaire, illustrée par plus d'une soixantaine de
sites documentés à ce jour dans les deux régions.
368 pages, Musées de la Ville de Strasbourg, 2013 (35
euros)
|
De l'usage stratégique de la ruine de château fort : la
reconversion de quelques sites de châteaux du Val Saint-Grégoire
La stabilisation du front sur les hauteurs des Vosges a
eu pour conséquence d'impliquer dans la tourmente de nombreux sites de châteaux
forts, qui retrouvaient ainsi partiellement des fonctions défensives perdues
depuis leur abandon. Leur position dominante valut en effet à des ruines d'être
utilisées pour installer des postes d'observation, voire de se retrouver en
pleine zone de combats : Hohrupf ou ncore Freundstein ont été, par exemple,
associés aux combats du Grand Ballon. En revanche, d'autres sites, investis par
l'armée allemande afin de contrer un éventuel percement du front principal,
existent dans la vallée de Munster, où un certain nombre de hauteurs furent
intégrées dans une ligne de défense supplémentaire. Celle-ci était censée
arrêter toute progression française qui aurait pu déborder la ligne allant du
Linge à Metzeral par le "Sattel".
Du début de l'été 1915 jusqu'en 1918, la croupe
montagneuse du Hohlandsberg sur le Staufen a été dotée de postes d'observation,
puis d'un réseau de tranchées et d'abris répartis sur les hauteurs, sans aucun
ménagement pour les anciens sites castraux. La montagne porte plusieurs ruines
de châteaux du XIIIe siècle, de Pflixbourg au nord jusqu'à Haut-Hattstatt au
sud. La crête est dominée par le sommet du Staufen (altitude 896 m), où se
trouvent des vestiges d'un château bâti par les Girsberg autour de 1281.
Surplombant immédiatement le débouché de la vallée, le château de Pflixbourg a
été mis en défense dès 1915. Des tranchées ont été établies dans le fossé
principal et plusieurs points d'appui disposés à l'extérieur. Abritée par la
ruine, une terrasse pour des baraquements a été aménagée sur le versant est, au
niveau du petit col isolant le château du reste du massif. Puis, une seconde
ligne de front a été créée en 1917 par crainte du franchissement de la vallée
par l'armée française. Le secteur du Staufen a donc été intégré dans une
barrière faite de tranchées continues et de barbelés dénommée "Honack-Staufen-Riegel".
N'ayant finalement pas été exposées aux combats, ces structures, bien que
fragilisées par le siècle écoulé depuis leur construction, présentent un état de
conservation parfois remarquable.
La conception commune de ces aménagements visait à créer
des abris défensifs et non des structures de combat. Ils étaient destinés à la
seule protection des hommes et du matériel et se présentaient sous deux formes :
casemates en béton coulé sur un tunnel de tôle ondulée cintrée dénommée
"Hindenburg" (Staufen) ou tunnels à une ou deux entrées creusées dans
la roche (Pflixbourg, Hohlansbourg, Haut-Hattstatt) selon les technique de mine
(Stollen). Leurs entrées étaient
renforcées par des coffrages bétonnés. A l'exception de l'abri du Hohlandsbourg,
ces installations étaient dissimulées par des fossés ou les versants, les fossés
médiévaux offrant l'avantage de former des tranchées préexistantes. Les
installations de Haut-Hattstatt ont été complétées par des terrassements
éventrant les fossés sur le versant nord et leurs décombres ont été utilisés
pour la construction d'une terrasse d'accès. [...]
Jacky Koch (page 63)
Notices de sites
Wintzenheim "Hohlandsberg" : un massif
fortifié allemand
Une prospection inventaire prenant en compte l'ensemble
du massif du "Hohlandsberg" de la Préhistoire à la Grande Guerre a été réalisée
dans le cadre d'un programme collectif de recherche. Un relevé LIDAR complet
suivi d'une prospection de terrain ont permis d'identifier une centaine
d'anomalies ou groupes d'anomalies, dont vingt-six peuvent être attribuées à des
aménagements de la Grande Guerre. A l'intérieur de ce corpus, dix-neuf
structures sont construites en pierres (maçonnées ou non) et sept autres
comportent du béton.
D'une manière générale, on distingue plusieurs types d'aménagements :
- les structures fossoyées non appareillées : emplacements de baraquements en bois et tranchées simples, non maçonnées
(site n° 46) ;
- les structures fossoyées appareillées : substructures d'abris individuels ou collectifs (sites n° 36 et 37), tranchées
de type tirailleur (sites n° 40, 41 et 50), et abris divers (sites n° 42,43, 47, 48, 51 et 52) ;
- les structures bétonnées : observatoires (site n° 39), structures rocheuses naturelles aménagées (site n° 53) et abris
(sites n° 34 et 35).
Deux entrées de galeries possèdent des frontons en béton
moulé où figure une croix de fer associée à l'année 1916. Chacune d'entre elles
porte une devise : "Maul halten !" (Taisez-vous !) et "Durchhalten !" (Tenez bon
!). A l'intérieur de ces galeries, on note la présence de dédicaces permettant
d'identifier les régiments ayant participé à l'aménagement de la position.
L'analyse du LIDAR, des plans directeurs de tirs et des
cartes militaires des deux camps permettent de mieux appréhender ces vestiges en
identifiant une ligne continue de défense située sur le rebord ouest et sud du
massif. Celle-ci est constituée de tranchées associées à des abris et des
réseaux de fil de fer barbelé. On note également la présence dans un secteur
central isolé d'une zone d'entraînement caractérisée par la présence de trois
galeries. D'un point de vue général, ces aménagements correspondent à une ligne
de défense allemande liée à la stabilisation du front. La position de défense
d'arrière-front du massif du "Hohlandsberg" se compose d'une organisation
fortifiée de hauteur permettant à l'armée allemande de répondre à deux objectifs
territoriaux à l'est du champ de bataille du Linge, en couverture de la vallée
de la Fecht sur la ligne Munster/Colmar. Il s'agissait d'abord d'établir des
observatoires sur les sommets ayant une vue directe sur la ligne de front et de
communiquer par relais optiques entre la ligne de front et les centres de
commandement. Parallèlement, l'établissement d'aménagements militaires sur ce
massif permet la création de verrous fortifiés de hauteur occupés de manière
permanente ou ponctuelle en cas de fluctuation de la ligne de front ou de coups
de main sur les positions allemandes arrière. Deux types de structures
caractérisent cette position : des emplacements militaires à vocation défensive
(verrous de cols ou de vallée, fortifications de hauteur, postes de défense
anti-aérienne) et à vocation technique (postes optiques relais, postes
d'observation).
Michaël Landolt (pages 308 et 309)
Copyright Guy Frank 2014
Retour au Sommaire